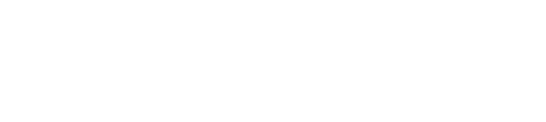Dans le cadre du développement d’un réseau, un franchiseur peut être amené à diversifier le type de contrat de franchise le liant à ses collaborateurs franchisés. Parmi cette multitude d’accords existe la franchise participative. Ce type de contrat implique le franchiseur dans l’apport du capital d’un franchisé pour le démarrage de son activité. Il est souvent envisagé lorsqu’un franchisé ne dispose pas des fonds nécessaires pour l’ouverture du point de vente. Dans cet article, nous comprenons ensemble les intérêts de ce système hybride pour un franchiseur.
1 - La franchise participative : qu’est ce que c’est ?
La franchise participative est un type d’association entre franchisé et un franchiseur, où ce dernier investit un apport dans le capital d’ouverture du nouveau point de vente du franchisé. Sa participation à travers son financement, toujours minoritaire, peut permettre à un franchisé de démarrer son activité lorsqu’il n’a pas les fonds nécessaires. En effet, l’investissement du franchiseur ne peut dépasser les 49% d’investissements. Le point de vente est considéré comme une filiale du franchiseur, où son pouvoir de décision reste limité par la minorité de son apport au capital. Cependant, sa participation lui donne un droit de blocage des décisions importantes prises pour l’entreprise franchisée. Si le capital du franchiseur dépasse les 50%, le franchisé devient un directeur de filiale, et la notion de franchise perd de son sens.
Pour certaines raisons que nous évoquerons dans la 3ème partie de l’article, ce type d’association réveille la prudence de certains avocats, autant pour les franchisés que les franchiseurs. C’est pourtant une solution qui tend à se développer lors du développement d'une enseigne, notamment dans les réseaux de distributions alimentaires.
2 - De quoi se compose le cadre contractuel d’une franchise participative ?
Même si cet accord est spécial, la franchise participative impose le respect de certaines règles et son équilibre repose sur la formation d’un contrat complet composé des éléments suivants :
- le corpus contractuel : cette partie du cadre se compose du document d’informations précontractuel, du précontrat et du contrat de franchise proprement dit. Ces documents sont la base de tout contrat de franchise, quel que soit le type de réseau.
- les accords des associés : cette partie du cadre contractuel réunit le pacte d’associés décrivant toutes les circonstances liées à la vie de l’entreprise tout au long de son existence, les statuts de la société franchisée et ses accords financiers. Ces accords vont fixer les règles entre les différentes parties, ainsi que leurs droits et obligations.
- les conventions annexes : ces conventions se concentrent sur les moyens dont le franchiseur donne accès au franchisé pour les besoins de son point de vente. Ces annexes concernent principalement l’approvisionnement et les prestations de gestion de la société ( comptabilité, traitement de l’information, outils de communication… )
3 - Quelles sont les limites de la franchise participative ?
Dans le droit, le code de Déontologie Européen de la fédération européenne de la franchise définit la franchise comme “ un système de commercialisation [...] basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement indépendantes.” La franchise participative est donc une pratique controversée dans le monde de la franchise, considérée comme une entorse au concept de base, rimant avec indépendance des acteurs.
En effet, tous les reproches faites à ce système de collaboration se concentrent autour de cette perte d’indépendance de franchisé. Le franchiseur est vu comme une possible contrainte pour le franchisé lors de sa prise de décision, ayant une vue directe sur la gestion intérieure de l’entreprise franchisée. Certains parlent même de “ salariat déguisé”.
Pour le franchiseur, les limites se concentrent sur la complexité de la gestion d’un tel système, administrativement mais également financièrement si le franchiseur décide de multiplier de tels contrats au sein de son réseau.
Enfin, son implication dans les affaires de la société franchisée peut amener le franchisé à ne pas se sentir responsable de la bonne tenue de son point de vente, entraînant ainsi un laisser-aller voire une défaillance de la part du franchisé.
En conséquence, un tel accord augmente le risque de litiges entre les deux parties.
4 - Quels intérêts pour un franchiseur ?
C’est pourtant une solution de plus en plus appréciée qui tend à se développer dans le processus d'ouverture de franchises.
L’intégration du financement du franchiseur dans le projet est le signe qu’il croit en le potentiel en le projet de ses franchisés, ce qui leur permet de gagner en crédibilité. C’est aussi le moyen pour eux de se sentir accompagnés dans le démarrage de leur activité, pour les démarches administratives mais aussi financières par manque de fonds lors du démarrage de son activité par exemple.
Pour le franchiseur, l’établissement d’une franchise participative est le moyen d’avoir un pouvoir d’action de plein droit sur la réussite d’une entreprise de son enseigne, et ainsi pousser son réseau au succès. Il accède plus facilement aux informations internes de la société, et se protège mieux de la concurrence. En effet, l'avantage concurrentiel est essentiel pour la pérennité d'un réseau de franchise. Cette visibilité lui permet de prendre les décisions adéquates pour le bien-être de son réseau.
La franchise participative est un système de collaboration juridique et financière permettant au franchisé d’être accompagné dans le démarrage et la gestion de son activité, et au franchiseur de préserver les points de vente stratégiques et au fort potentiel de son réseau de la concurrence. Pour éviter les désaccords et le manque d’équilibre entre les parties, il convient d’établir un cadre contractuel clair, où les limites et obligations de chacun sont clairement énoncées.